 |
| Épisode du renversement de traîneau à Sainte-Anne-de-la-Pérade, tel que représenté par le graveur sur bois français Noël-Eugène Sotain (1816-1874), d'après le récit d'Adolphe de Puibusque présenté ci-dessous. Cette gravure a d'abord été publiée en 1861 dans le Courrier des familles, à Paris, ornant le récit de Puibusque qui y fut publié pour la première fois. (Source : Journal de l'Instruction publique, Montréal, mars 1862 ; cliquer sur l'image pour l'agrandir) |
 |
| Une trace manuscrite du passage chez nous d'Adolphe de Puibusque est conservée aux Archives nationales du Québec. Il s'agit de ce sonnet, intitulé L'illusion détruite, signé par lui et daté du 23 avril 1850. (Source : BANQ ; cliquer sur l'image pour l'agrandir) |
Adolphe de Puibusque a composé un « bouquet » intitulé
Les couleurs du Canada, sur une musique d'Octave Pelletier
et offert à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.
Pour prendre connaissance du texte et de la
partition musicale, cliquer sur cette image :
 |
| Le Journal de Québec, 7 juillet 1863. (Source : BANQ) |
 |
| L'Ordre, 8 juillet 1863. (Source : BANQ) |
Note de l’auteur : Ces notes sont empruntées à un voyage que j’ai fait avec ma femme au Canada ; si je les publie si peu de temps après avoir perdu cette compagne chérie de vingt-trois ans de mon existence, c’est que je cherche des consolations dans tout ce qui me la rappelle. Jusqu'ici, il ne m’a pas été possible d’en trouver ; mais du moins, en ne me séparant pas d'elle, j’ai peut-être mieux supporté ma douleur.
Note de la rédaction du Journal de l’Instruction publique : Nous sommes heureux de reproduire cette esquisse dont la couleur locale est si vive, et le style si naturel et si charmant. Nos lecteurs qui tous ont fait connaissance avec l’auteur par la lecture des poésies qu’il veut bien nous envoyer de temps à autre, partageront l’émotion que nous ont inspirée les lignes qui suivent.
8 janvier. Mardi.
Thermomètre Réaumur. —7 degrés au-dessous de zéro ; — Vent Nord-Est.
Enfin
nous partons. Aller de Montréal à Québec en plein hiver n’est pas la chose la
plus simple du monde —Adieu les commodes steamboats
qui nous transportent en l’espace d’un sommeil au pied du Cap Diamant ; la
navigation est fermée, le Saint-Laurent ne marche plus que sous une voûte de
glace, et les chemins de fer de ses rives n’existent encore qu’en projet. Il
n’y a de choix pour le voyageur qu’entre le stage
et l’extra. Le stage ne fait qu’une couchée ; il arrive à Québec à la fin du
second jour ou dans le cours du troisième, selon l’état de la route ; le prix
est de 10 piastres (50 francs). Il y a quatre places et chaque voyageur a droit
à une robe de buffle. L’extra est
plus petit ; il est à deux places seulement ; on change de voiture et de
chevaux à chaque poste, c’est-à-dire de cinq lieues en cinq lieues, et l’on
continue le voyage à volonté. On peut parcourir six postes ou ne faire qu’un
relais si on le préfère, liberté précieuse dans une saison où, d’une heure à
l’autre, le temps et la route subissent les plus graves changements ; mais ce
privilège est celui du riche, il faut donc le payer et assez cher ; 30
piastres, un peu plus de 155 fr.—Deux state-rooms
d’un steamboat avec un souper ne
coûtent que 5 piastres, environ 25 fr., différence en plus 125, sans compter
les frais d’auberge et la perte de temps. Ces petits détails, insignifiants
aujourd’hui, pourront devenir intéressants par la suite. Si l’état des routes
indique le degré de civilisation d’un pays, la nature et le prix des voies de
transport offrent d’époque en époque une échelle comparative sur laquelle on
peut mesurer le progrès. Nos ancêtres auraient été bien fiers de ce que nous
dédaignons, et peut-être arrivera-t-il que nos derniers perfectionnements
feront sourire de pitié nos arrière-neveux.
Deux
difficultés précèdent tout départ au Canada dans cette rude saison : l)
s’habiller ; 2) entrer dans la voiture. Au temps de l’arme blanche, quand on
allait en guerre, il fallait couvrir toutes les parties vulnérables du corps ;
chacune avait sa cuirasse : casque, visière, haubert, brassards, gantelets,
cotte de mailles, corset bardé de fer ; sans un écuyer, on n’aurait pu tout
ajuster ; il fallait être aidé par deux pages pour arriver en selle, et quand
on était désarçonné on ne pouvait se relever sans le secours de plusieurs
valets ; il en est à peu près de même pour un touriste européen qui se hasarde
à faire un voyage d’hiver ici. Son armure de martre, de castor, de buffle et de
mink (vison) le céderait à peine pour le
poids aux armures d’acier du moyen âge ; mais on a beau se fourrer et se
draper, le froid trouve toujours quelque défaut de cuirasse ; ainsi doublé ou
triplé, comment s’enchâsser dans l’étroite boîte d’un sleigh qui n’a pas trois pieds de largeur ? Il faut être soulevé,
poussé, tiré, et finalement enfoncé. Cet emballage violent a, du moins,
l’avantage de réchauffer, et une fois entré dans le sac de buffle, on peut
crier avec confiance : All right !
Nous n’avons pas à nous plaindre de notre départ ; il s’est fait avec un
certain décorum. L’entrepreneur des postes était venu en personne présider à la
cérémonie, et les spectateurs ne manquaient pas. À Paris nous en aurions eu
cent ; car jamais, excepté en Carnaval, on ne vit caricatures si grotesques.
Pourquoi ne conserverai-je pas la liste de mes armes défensives ? Cet
inventaire m’égaiera quand je serai en pays chaud, et les costumiers pourront
en faire leur profit.
Commençons
par la tête : casque de martre ouaté en dedans avec oreillères à queue nouant
sous le menton ; voile de gaze verte pour préserver les yeux de l’éclat de la
lumière sur la neige ; crémone ou pèlerine de martre couvrant les oreilles, la
gorge et la poitrine ; cache-nez de mérinos faisant deux tours et maintenant la
coiffure et les pièces du cou étroitement fermées ; un gilet ou plutôt une
tunique de flanelle ; une chemise, un carré double de flanelle sur la poitrine
; deux paires de bas de laine, des genouillères épaisses, des chaussettes de
coton, un caleçon de caribou, un pantalon de drap de cuir, des dessus de jambe
d’étoffe canadienne, des bottines de castor double et à seconde semelle de
caoutchouc ; un gilet droit en drap de cuir-laine descendant jusqu’aux jambes
(mode Louis XV) ; des manches ouatées, un paletot ouaté avec parements, collet
et revers de fourrure fine de castor, le collet se relevant et enveloppant la
tête presque en entier ; enfin un pardessus de buffle bien doublé et croisant
du haut en bas avec un capuchon semblable ; gants de laine élastique et
gantelets pardessus en fourrure de minks.
Si tout ce bataclan ne pèse pas 200 livres, peu s’en faut, à coup sûr.
Pour
ma femme, je ne supposerai que 100 livres ; cela fait 300, et le poids des deux
personnes réunies, élevant ce chiffre presqu’au double, nous permettait de
maintenir la voiture dans un équilibre parfait ; nos bagages, attachés
derrière, ne pesaient pas plus que nous. Pour expliquer toutes ces précautions
prises contre le froid, il faut dire que les traîneaux entièrement ouverts
devant et sur les côtés ne se ferment qu’avec des rideaux de cuir assez mal
ajustés et que le vent y entre sans le moindre obstacle.
La
première poste se termine au Bout-de-l’île de Montréal, sur la rive gauche de l’Outaouais,
qui débouche dans le Saint-Laurent sous le nom de Rivière-des-Prairies. Au
commencement et à la fin de la saison, ce point est dangereux ; on fait même un
grand détour pour l’éviter, mais à présent la glace est si solide et si unie
que nous avons passé la rivière sans nous en apercevoir ; il y a là une auberge
isolée tenue par un nommé Deschamps ; on nous y a fait descendre pour nous
réchauffer, et ma foi, il était temps ; le nordet qui nous soufflait au visage
avec force nous avait empourpré le nez et le front ; nos yeux pleuraient ; le
poêle a renouvelé notre provision de chaleur pour la seconde poste.
 |
| En hiver, le Bout-de-l'île de Montréal, là où se rejoignent la Rivière-des-Prairies et le fleuve Saint-Laurent. (Source : BANQ) |
Deschamps
tient sa maison comme tous les Canadiens-Français qui habitent la campagne ;
c’est simple, propre, commode ; une famille nombreuse s’empresse autour des
voyageurs pour les aider à ôter et à remettre leur attirail fourré. Si l’on
était forcé de prendre gîte en pareil lieu, on ne serait pas à plaindre ; on y
trouverait avec ce qu’offre ordinairement la campagne, tout ce qu’il n’est pas
ordinaire de trouver à la ville : bonne figure d’hôte, bonne table et bon lit.
De
la pointe de l’île de Montréal à Lavaltrie , on continue à suivre la route de
terre en passant par Repentigny ; la poste est aussi de cinq lieues. L’auberge
de Lavaltrie est tenue par des Canadiens-Anglais ; c’est une maison spacieuse
et de bonne apparence ; toutes les dispositions intérieures rappellent les
hôtels des petites villes de l’Amérique et du Canada ; le parloir des voyageurs
est un salon garni, suivant l’usage, de rocking-chairs
dont le dossier et les bras sont couverts d’un filet en coton blanc imitant la
dentelle, d’un piano, d’une table ronde avec livres, keepsakes et colifichets de fantaisie, d’ottomanes en crin noir et
d’un tapis à grand ramage.
Notre
station à Lavaltrie a été si courte que nous n’avons pu éprouver toutes
les bonnes qualités de cette auberge ; nous ne pouvons louer en connaissance de
cause que la netteté des appartements et la politesse des maîtres.
Lavaltrie forme une saillie sur le bord du Saint-Laurent avec un bouquet de hautes futaies dont la beauté m’a frappé dans la belle saison, lorsque je descendais vers Québec en steamboat. À présent ce feuillage magnifique est remplacé par les frimas ; c’est un tout autre tableau, mais qui n’est pas, assurément, sans quelque charme.
 |
| Le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Lavaltrie. (Source : La Relève) |
Le
chemin de terre que nous avons suivi depuis Montréal est assez bien fait, nous
n’y avons rencontré que peu de cahots ; cependant la neige qui le couvre, bien
que fortement pressée par la herse et le rouleau, résiste toujours, tandis que
sur la glace un sleigh glisse sans
exiger des chevaux le moindre coup de collier. Nous observons avec plaisir la
différence de ces deux voies eu passant de la terre sur le fleuve : notre
marche s’accélère ; elle doublerait aisément de vitesse sans les rencontres
fréquentes qui nous obligent à faire halte. La route élevée en chaussée par les
couches de neige qu’on y a successivement jetées pour la réparer est si haute
qu’on ne peut incliner dans le débord, et si étroite qu’il est extrêmement
difficile dépasser côte à côte. Voilà pourquoi l’attelage est disposé en
arbalète et la caisse de la voiture réduite aux propositions les plus exiguës.
9 janvier. Mercredi. De Berthier aux Trois-Rivières.
Après
avoir passé Lanoraie vers le coucher du soleil, nous sommes arrivés à Berthier,
un peu avant la nuit. Berthier est une des paroisses les plus importantes du
Bas-Canada ; la culture a pénétré au loin dans la profondeur des terres et les
propriétés acquièrent chaque année plus de valeur ; cent acres valent déjà de
15 à 20 mille francs ; les Anglais ont accaparé les meilleures ; c’est la
famille Cuthbert qui possède les seigneuries de Berthier et Lanoraie. Madame
Ross Cuthbert est sœur de M. Rush, qui fut ministre des États-Unis à Paris. La
seigneurie d’Ailleboust, située derrière celle de Berthier, n’est pas encore
concédée en entier ; la propriété en est indivise entre plusieurs
Français-Canadiens.
Deux
hôtels se font concurrence à Berthier ; nous avons été conduits chez Giroux ;
sa maison mérite une mention très honorable et ses chapons aussi; pareille
volaille ne nous avait jamais été servie depuis notre départ de France, et nous
l’avons accueillie comme une heureuse tradition du Maine (en France). Après nous être
lestés d’un déjeuner bien chaud et avoir quelque peu causé avec Madame Giroux, nous
commençons notre travestissement, moi en bête fauve, Élisa en bête noire ; j’ai
refusé hier de mettre un voile, et la gelée m’a laissé sur le front une
empreinte brûlante ; la réverbération du soleil sur la neige m’a fatigué aussi
la vue ; une gaze verte, si mince qu’elle soit, n’est pas seulement un rempart
contre le vent et la lumière, elle forme une atmosphère plus tempérée et
adoucit l’éclat des objets. J’ai donc mis toute pruderie de côté, je me suis
voilé.
Madame
Giroux, en nous faisant ses adieux, nous a dit : « Le nordet vient de tomber ; il
va mouiller ». Elle ne se trompait
pas, la neige a commencé presque aussitôt ; seulement elle était si
parfaitement gelée qu’elle était plutôt poudreuse qu’humide. Quel changement de
décoration ! Voici pour notre seconde journée un tableau d’hiver entièrement différent
de celui que la première journée nous a présenté. Hier, tout était bleu au
ciel, limpide dans l’air, resplendissant sur la terre. Aujourd’hui, une brume
jaunâtre resserre l’horizon autour de nous, une neige épaisse tombe lentement ;
il ne fait ni jour ni nuit ; c’est la clarté opaque de la Laponie ; on ne
distingue que les contours des objets comme si l’on n’était entouré que d’ombres.
La couleur, le mouvement, la vie, tout semble enseveli sous un immense linceul.
Et
qu’a-t-il fallu pour opérer cette transformation générale ? Un coup de vent ;
le sud a chassé le nordet, qui a disparu avec tous ses prismes pour aller sans
doute illuminer les palais de cristal et les montagnes de diamants des mers
polaires. Chacun son tour. Quelques rares éclaircies nous laissent voir le pays
que nous traversons. La paroisse de Berthier se prolonge sur tout son
front en forme d’avenue. Les maisons sont aussi rapprochées que dans les villes
rurales des États-Unis ; des plaines se déroulent ensuite à perte de vue et
l’œil n’y trouve pas un seul arbre pour se reposer ; la neige en couvrant
jusqu’aux clôtures a donné à ces plaines l’apparence de lacs de lait ou
d’argent ; on ne voit pas une seule tache sur ces surfaces d’une blancheur
inimitable ; çà et là dans le lointain, à droite, l’œil distingue avec peine
une file de points noirs qui se meuvent ; c’est une suite de trains, une
caravane traversant les déserts du Saint-Laurent.
Plus
on s’éloigne de Montréal, plus l’entretien des routes est négligé ; pour éviter
d’y faire des réparations, on en fait de nouvelles et pour cela il suffît de
changer de place les jalons ou balises, arbustes verts faciles à transporter ;
néanmoins les cahots une fois ouverts se creusent bien vite, et quelle que soit
l’habileté du conducteur, on est sans cesse exposé à d’affreuses secousses. Le
charretier canadien est admirable : doux, poli, attentif, il mène toujours
debout, et, dans les mauvais pas, il s’agite comme sur une balançoire, se
jetant tantôt à droite, tantôt à gauche, sautant même hors la voiture, pour
faire contrepoids et rétablir l’équilibre. Vent, neige, grêle, il reçoit tout
dans une noble attitude de combat, et son attention ne s’endort jamais. Rien d’intéressé
dans ses soins ; le pourboire est mis hors d’usage avec l’ivrognerie ; membres
de la société de tempérance, la plupart des postillons passent devant les
tavernes sans même les regarder, mais ils ne manquent jamais de saluer les
croix plantées au bord des routes.
Nous
avons relayé à Maskinongé. L’auberge de la poste est inférieure aux
précédentes, et cela n’est pas surprenant ; à moins d’accident, aucun voyageur
ne s’arrête là, il n’y a que les habitants allant d’une paroisse à l’autre ;
cependant, la maison, malgré sa simplicité rustique, est très propre et on
pourrait y séjourner sans la moindre répugnance, la modeste catalogne du pays y
protège le tapis anglais ; des gravures ou lithographies dont les sujets sont
religieux ornent les murs peints en blanc ; une vieille pendule haute de cinq à
six pieds y sonne dans sa boîte de bois peint les heures du XIXe
siècle aussi fort et aussi juste que celles du XVIIIe et peut-être du XVIIe ;
elle a pour rival dans la pièce d’entrée le cadran économique des États-Unis,
qui, tout compris, mouvement, sonnerie, glace et cadre d’acajou, n’a coûté
qu’un dollar.
Sur les bords étroits d’une haute cheminée, j’aperçois des figures en plâtre, des anges, des vierges, des Napoléons, des coqs et diverses espèces d’animaux, sans parler des gros coquillages symétriquement placés aux deux bouts. Tandis qu’on relayait, l’engagée, c’est-à-dire la servante, est venue prêter main-forte à Élisa pour l’aider à se débarrasser de ses fourrures ; la bête noire étant devenue blanche, on ne savait par quel bout la prendre ; aussi la bonne engagée ne cessait-elle de répéter : « C’est de valeur comme il mouille ! Espérez, madame, espérez ; on va vous ôter tout votre butin ; on ne quittera que le chapeau si vous voulez le garder sur votre tête ».
De
Maskinongé à Machiche [Yamachiche], nous n’avons eu rien à remarquer ; l’air
était entièrement obscurci par la neige. L’église de Machiche a été construite
sur le même plan que celle de Maskinongé. —Est-elle plus grande ou plus
nouvelle ? Je l’ignore ; mais l’extérieur m’a paru mieux. Machiche est une des
paroisses les plus populeuses et les plus riches de cette partie du Canada ;
elle a un marché très suivi. Après l’avoir passée, on arrive à la pointe du lac Saint-Pierre, où est le relais de la poste.
Le
lac Saint-Pierre est le plus large épanchement du Saint-Laurent entre Kingston
et le Saguenay, espace de plus de 150 lieues ; on pourrait l’appeler le défaut
du fleuve, car il enlève chaque année plus d’un mois d’activité à la navigation
: c’est la partie la plus basse ; elle prend la première et débâcle la
dernière. Le chenal est étroit; il y a partout peu de fond, et malgré les
dépenses énormes qui ont été faites pour creuser la passe principale, les
obstacles et les dangers sont à peu près toujours les mêmes. Les cageux (conducteurs de radeaux)
n’abordent le lac Saint-Pierre qu’avec effroi ; et il n’est que trop vrai que
si la tempête les y surprend par un fort nordet, ils courent les plus grands
risques. La Pointe-du-Lac est le rendez-vous favori des chasseurs de canards et
de bécassines ; la tranquillité des eaux qui baignent les îles voisines et
l’épaisseur des joncailles leur donnent la chance d’y faire de très heureuses
parties.
Le
village de la Rivière-du-Loup [Louiseville] qu’on trouve après la Pointe-du-lac semble florissant [L’auteur
fait une erreur : dans la direction de Québec, Louiseville précède Yamachiche qui est suivi de la Pointe-du-Lac. À l'époque, Louiseville s'appelait «Rivière-du-Loup en haut», tandis que le Rivière-du-Loup que l'on connaît de nos jours était «Rivière-du-Loup en bas»]. La maison seigneuriale, bâtie dans une
bonne situation, y produit un effet pittoresque malgré la lourdeur de son architecture
massive. Quelques Canadiennes se livrent, dans cette paroisse, à une industrie
qu’elles ont dérobée aux Sauvages ; elles brodent sur l’écorce de bouleau avec
des poils d’orignal et de porc-épic ; une madame Lambert a accaparé presque
toutes les commandes de Montréal, comme madame Paul de Lorette, celles de
Québec. Nous avions demandé un portefeuille pour notre album canadien à une
ouvrière d’élite, et comme ce travail délicat exigeait quelques explications,
nous avons fait halte devant sa porte. Mademoiselle Louise Mousset (c’était le
nom de cette ouvrière) se couvrant la tête d’un châle, à la façon des
Irlandaises, est venue au bord du grand chemin, et là, entre deux neiges, celle
tombant et celle tombée, on a discouru sur les guirlandes de fleurs et de
fruits ; on a parlé roses, violettes, pensées, fraises et groseilles.
Depuis
Maskinongé, nous avons voyagé alternativement sur la neige et sur la glace, en
terre ferme et sur les rivières ; mais nous n’avons repris le Saint-Laurent
qu’à la Pointe-du-Lac, et encore, pour le quitter bientôt. Le lac Saint-Pierre,
enveloppé d’une brume impénétrable, nous a échappé ; nous l’avons côtoyé sans
le voir ; notre regard par moments ne dépassait pas les oreilles des chevaux ;
nous avions à traverser plusieurs bois, et la neige que le vent ne peut balayer
y est plus entassée que dans les plaines. Notre charretier s’agitait devant
nous comme le diable dans un bénitier ; — quelle gymnastique ! Certes, il ne
devait pas avoir froid ; mais il avait beau faire, nous avons cahoté, penché, barodé tant et plus. Par instants, les
divinités de l’hiver, je ne sais quel nom leur donner, les nivines, si l’on veut, puisqu’on a des ondines, élevaient leurs voiles diaphanes et nous découvraient des
beautés fantastiques ; la neige, mousseuse comme la crème battue, ne présentait
sur tous les arbres que des formes molles et légères, on eût dit du marbre
amolli, de l’albâtre fusible ; les branches horizontales des sapins
s’inclinaient à peine sous des flocons agglomérés en boules qu’on aurait pris
pour des nids de coton remplis d’oiseaux blancs ; ailleurs, un bloc occupait
plusieurs étages de l’arbre ; mais les interstices ouverts par la pointe des
rameaux marquaient des yeux, un nez, une bouche ou seulement des traits assez
irréguliers pour en faire une figure de monstre. Sur plusieurs gros troncs
d’arbres coupés la neige s’était amoncelée en colonnes torses, en pyramides ou
en statues grotesques.
Figurez-vous
nos anciens voyageurs isolés dans les bois ; qu’y voyaient-ils et que n’y voyaient-ils
pas ? Les Sauvages ne s’avançaient qu’avec précaution, examinant chaque arbre,
observant chaque buisson, et croyant au moindre souffle de la brise qui
balançait toutes ces figures étranges qu’elles allaient s’animer pour leur
fermer la route. Ils entendaient aussi dans le lointain le chasseur blanc qui
poursuivait avec des chiens blancs des chevreuils blancs ; meute, chasseur et
gibier, tout se dessinait pour eux sur les flancs des nuages. Ces visions de la
peur ou de la superstition, la poésie me les a rendues et j’ai senti que la
pâle muse du Nord habitait comme ses sœurs un monde enchanté. La mythologie née
du côté de l’Orient a oublié cette habitante des frimas ; elle ignorait aussi
les willis et les sylphides que la
ballade allemande a rencontrées dans la brume des lacs et dans l’ombre des
forêts. — Pourquoi ne pas compléter cette famille charmante en y ajoutant les nivines ou frimatides qui viennent de nous apparaître dans les neiges du
Canada ?
Arrivons aux Trois-Rivières. Il est cinq heures et demie et la nuit approche ; elle semble déjà nous envelopper, tant la neige qui nous aveugle est serrée. On nous mène chez Bernard. La venue d’un extra est toujours accueillie dans les hôtels comme une bonne aubaine. Si l’on ne crie pas ainsi qu’autrefois en Angleterre : « Bougies pour quatre chevaux ! », du moins le landlord accourt à la portière et l’ouvre lui-même pour donner l’exemple de l’empressement. Nous n’avons garde de trouver ces soins importuns ; ils nous paraissent au contraire pleins d’à-propos, car la pesanteur de nos fourrures est augmentée d’un poids de neige et de glace qui excéderait nos forces si nous cherchions à le soulever nous-mêmes. Le thermomètre en remontant tout à coup vers zéro a commencé un dégel qui ajoute une assez belle quantité d’eau à notre couverture de frimas. Mon buffle surtout a filtré dans sa laine des givres qui se sont allongés en girandoles et qui tintent comme des grelots. Je fais en marchant le bruit d’un lustre. Toute notre défroque étendue sur des chaises remplit un salon et le change en séchoir ; mais vivent les Canadiennes ! Elles nous soignent comme de vieux amis, et avec un si bon feu, un si bon souper, un si bon lit, comment n’oublierait-on pas bien vite les fatigues du voyage ? Il ne doit en rester que les impressions, et en effet, je n’ai rêvé pendant toute la nuit que mes songes du jour.
10 janvier. Jeudi.
On
annonçait la pluie hier soir ; le vent a tourné, et ce matin à sept heures le
thermomètre, dégringolant plus vite qu’il n’avait monté, marquait dix-huit
degrés au-dessous de zéro, —heureusement, nous ne marchons pas aujourd’hui ;
nous voici au milieu de notre voyage ; nous avons fait trente lieues, et il
nous en reste exactement le même nombre à faire. —Nous allons prendre un repos
; si je ne me trompe, l’hôtel Bernard est situé au bord du Saint-Laurent ; je
dois donc avoir une vue agréable, car le fleuve est libre sur ce point et la
marée lui imprime chaque jour deux cours différents. Voyons : Je regarde à une
fenêtre du nord, je regarde à une fenêtre du sud, pas de Saint-Laurent ;
qu’est-ce que cela signifie ? Voilà bien cependant de l’autre côté de la rue
l’hôtel Ostrom, où j’ai logé il y a deux ans. Curieuse inversion ! C’est au
pied de cet hôtel que le Saint-Laurent coule aujourd’hui ; évidemment, le
fleuve n’a pas changé de cours, il faut donc que l’hôtel ait changé de place ;
le mot de l’énigme m’est expliqué : les deux aubergistes ont troqué ensemble.
Je
viens de dire que la marée porte jusqu’aux Trois-Rivières ; ses derniers flots
y jettent chaque année vers la fin de décembre une manne précieuse : ce sont de
petits poissons que l’on suppose de jeunes morues et que l’on appelle Tommy-cods [Il s’agit de ce
qu’on appelle de nos jours les « petits poissons des chenaux »] Les longs
caissons qui servent à les prendre en sont encombrés ; on fait geler ces
poissons et on les vend au boisseau sur les marchés de Montréal et de Québec ;
ils sont aussi délicats que les éperlans.
Le
pont de glace se forme rarement entre les Trois-Rivières et le côté sud du Saint-Laurent.
On a fait celte année une tentative ingénieuse pour vaincre la double
résistance du courant et de la marée ; on a découpé dans le vaste épanchement
du lac Saint-Pierre une bande de glace beaucoup plus large que le chenal du
Saint-Laurent en face des Trois-Rivières. On espère que le reflux fera dériver
cette banquise qui, se trouvant resserrée dans un lit plus étroit, formera un
barrage. Cette combinaison peut réussir ; tout dépend néanmoins de l’épaisseur
de la glace ; si elle est mal liée, elle se brisera entraînée par fragments.
Il
y a peu de vie dans la cité des Trois-Rivières pendant la belle saison ; le
commerce, réduit au détail, y est presque nul. Qu’est-ce donc en hiver ? On a
ici un exemple frappant des conséquences désastreuses de tout monopole. Cette
ville, qui est la seconde en ancienneté du Canada, est assurément dans un état
de progrès voisin de son enfance. Les forges de Saint-Maurice, situées derrière
son territoire, en sont l’unique cause ; on a concédé tous les bois des
alentours à un seul homme sous prétexte d’en alimenter les hauts-fourneaux ; il
n’y a donc pas eu un seul acre défriché, pas un seul établissement formé, pas
une seule ferme, pas un seul moulin, et la rivière Saint-Maurice, dont les
déclivités offrent à l’industrie tant de riches pouvoirs d’eau, a continué à
couler, comme au temps des Sauvages, dans une solitude profonde. Qu’est-il
arrivé ? C’est qu’après trente ou quarante ans de jouissance de son privilège,
l’exploiteur des forges, M. Bell, est mort ruiné, et qu’en privant les
Trois-Rivières d’un accroissement de population, il a enlevé au commerce des
consommateurs et à l’agriculture des producteurs, c’est-à-dire tout moyen
d’échange et par suite toute source de richesse.
On
vient depuis peu de lever l’obstacle ; des concessions de terre ont été
accordées, et bien que les premiers occupants ne songent en général qu’à couper
le bois et à le vendre, ils fraient la route. Déjà même la seule exploitation
du bois a nécessité l’établissement de plusieurs moulins à scie, et les
ouvriers employés dans ces nouvelles usines forment de distance en distance des
hameaux qui ne tarderont pas à se changer en villages. En résumé, la population
des Trois-Rivières, au lieu de rester attachée aux bords du Saint-Laurent,
remonte le Saint-Maurice et envahit les terres du Nord ; de stationnaire, elle
devient active et marche vers le progrès.
Voulez-vous
savoir tout ce qui se dit ou se fait dans le monde ? Allez chez les femmes en
retraite. Voulez-vous savoir ce qui se passe dans une ville ? Allez dans la
ville voisine. C’est ainsi que nous avons appris ici un roman qui a passé
inaperçu sous nos yeux à Montréal.
11 janvier. Vendredi.
Hier
soir, en donnant un dernier coup d’œil au thermomètre, ce guide indispensable
du voyageur canadien, nous avons dit : « Si le mercure ne remonte pas de cinq
ou six degrés au moins, il sera impossible de se remettre en route ».
Heureusement, en quatre jours nous avons eu quatre temps différents, et si les
variations se succèdent avec la même régularité, nous ne serons pas condamnés à
prolonger notre séjour aux Trois-Rivières.
Cet
espoir s’est réalisé : nouveau tour de girouette, nouveau temps. De 18 degrés
Réaumur, le thermomètre remonte à 5 ; comparativement, c’est presque de la
chaleur ; il s’agit d’aller coucher à Deschambault, relais qui partage à peu
près également la distance des Trois-Rivières à Québec. Nous sommes en retard ;
il est déjà onze heures, et il sera difficile d’arriver avant la nuit.
Commençons par régler nos comptes : nous avons quatre repas et deux nuits ; on
nous a servis à part ; nous avons eu un feu perpétuel, on a mis sur notre table
du doré, des tommy-cods, des perdrix,
une dinde, le tout bien dressé et à point. Or, que nous demande-t-on ? Onze
shillings seulement (deux piastres et quart, environ douze francs). Est-ce croyable
? Pauvre Bernard ! À ce compte-là tu feras difficilement fortune. Ajoutez qu’on
nous a donné gratuitement pour plus de dix piastres de politesse, monnaie plus
coutante que 1’eau dans les campagnes du Canada.
Des
Trois-Rivières à Champlain, la route commence à devenir méchante, au dire des charretiers ; on suit constamment le littoral
qui s’élève peu à peu et forme des ondulations de plus en plus grandes. À peine
touchons-nous au pont des Trois-Rivières que la neige nous assaille ; elle
s’épaissit sans cesse et renouvelle pour nous le spectacle de mercredi dernier
; seulement, le théâtre n’est pas le même ; au lieu de bois, nous ne voyons que
des plaines ; ce n’est plus un lac, c’est une mer d’une blancheur que le lait
n’égale pas. Aux deux côtés de la route, la plupart des clôtures ont entièrement
disparu ; on n’aperçoit que l’extrémité de celles qui occupent des versants
élevés ; la neige qui couvre les traverses a débordé, mais elle n’est pas
tombée ; elle forme des guirlandes et des festons aussi gracieusement moulés
que sur un marbre de Canova.
La
paroisse de Champlain n’est pas d’une importance qui réponde au grand nom qu’on
lui a donné ; le fondateur de Québec méritait mieux. Le lac qu’on lui a
consacré et où il a tiré le premier coup de fusil est plus digne de lui. Quand
on se rappelle tout ce que cet homme éminent a fait à la naissance de la
colonie pour l’arracher à l’avidité de l’Angleterre, ses seize voyages en
Europe, ses heureux efforts auprès du cardinal de Richelieu, sa seconde
conquête, ses excursions, ses découvertes, ses établissements, on ne saurait
assigner à sa mémoire une place trop grande, et ce qui étonne, c’est que cette
place lui manque précisément à Québec qui lui a dû deux fois la vie.
Le
marché le plus voisin de la paroisse de Champlain, le marché des
Trois-Rivières, lui prend plus d’argent qu’il ne lui en rapporte ; en se
développant, il la développera ; elle attend depuis deux siècles ; elle peut
bien attendre encore.
L’auberge du relais ne paie pas de mine ; nous y avons laissé avec plaisir notre charretier des Trois-Rivières, qui paraissait fiévreux.
La
neige tombait de plus en plus fort ; on ne distinguait plus rien. Tout à coup,
elle a cessé, l’air s’est refroidi et des tourbillons de poudre blanche se sont
élevés de toutes parts. Le vent avait sauté du sud-ouest au nord-ouest, une
tempête de neige devenait imminente ; c’est la plus mauvaise chance de voyage
en cette saison ; il a fallu fermer à la hâte tous les rideaux de cuir opposés
au vent. Le charretier, faisant bonne contenance, a lutté intrépidement contre
une grêle que chaque rafale lui lançait au visage ; il sautait avec l’agilité
d’un singe d’un côté à l’autre de sa galerie ; mais, quelle que fût son
attention, il ne pouvait deviner toutes les fondrières que la neige lui cachait
; nous montions des côtes plus accidentées et plus roides oû tout cahot
semblait être le commencement d’une chute. Parvenus vers les premières maisons
de la paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade, nous nous précipitons dans un fond où,
sans verser, notre sleigh s’enneige
complètement ; on ne voit plus que la tête des chevaux et celle du conducteur.
Tout à coup nous inclinons à droite, et pour n’être pas ensevelis dans la
neige, il ne nous reste d’autre parti à prendre que de débarquer, ce qui n’est
pas facile. Tout nous fait obstacle ; la position de la voiture, les dimensions
étroites de la portière, la violence du vent, et les coups de fouet de la grêle
; enfin, l’un poussant l’autre, nous opérons notre escape, et nous voici plongés dans la neige jusqu’à la ceinture.
À
force de crier, le conducteur parvient à se faire entendre des maisons
voisines, et deux hommes armés de pelles arrivent le plus vite qu’ils le
peuvent à notre secours. Si nous commandons ce sujet à notre peintre ordinaire,
le tableau devra être disposé ainsi : une maison d’habitant avec corps de
ferme par derrière sur la croupe d’un coteau ; deux habitants sortant de la
maison, la pelle sur l’épaule ; les gens de la maison assemblés sur la porte et
criant à tue-tête sans pouvoir dominer la voix de leur chien ; au pied du
coteau un sleigh de poste peint en
rouge à demi-renversé et les brancards en l’air ; les deux chevaux dételés et
se débattant dans la neige ; le charretier luttant avec le premier cheval, qui
est tombé dans le débord ; le voyageur aidant de son mieux la voyageuse, dont
les deux bras élèvent au ciel un manchon plein d’anxiété ; enfin, un tapis de
neige au loin et au large, des tourbillons de grêle, et une suite d’arbustes
verts jalonnant la route.
 |
| La scène du renversement du sleigh d'Adolphe de Puibusque et de son épouse à Sainte-Anne-de-la-Pérade, telle que représentée par le graveur sur bois français Noël-Eugène Sotain (1816-1874). (Source : Journal de l'Instruction publique, Montréal, mars 1862 ; cliquer sur l'image pour l'agrandir) |
Les
chemins du Canada ont cela de bon qu’ils sont bordés de maisons séparées par de
courtes distances ; les voyageurs sont toujours à portée des secours. La maison
où nous avons pris refuge pourrait spéculer sur la fondrière où nous avons été
à moitié engloutis ; c’est le second accident de la journée, et la malle du
soir n’est pas encore arrivée. Un vieillard de haute taille, à figure fine et
intelligente, nous fait un accueil hospitalier ; ses filles et petites-filles
nous débarrassent de nos fourrures doublées de neige et semées de grêlons ; la
grand-maman file dans son coin, et une engagée
carde la laine. Ce vénérable patriarche, qui achève sa vie dans le repos, a vu
de plus rudes pays que nous ; c’est un ancien voyageur de la Compagnie du Nord-Ouest.
Pierre Bellie est d’origine écossaise ; il descend d’un de ces braves Highlanders catholiques qui restèrent
fidèles aux Stuarts longtemps après le désastre de Culloden. Un de ses fils est
curé du Cap-de-la-Madeleine, village pittoresque situé à l’est des
Trois-Rivières, à peu de distance de l’embouchure du Saint-Maurice. Nous avons
visité son église, il y a deux ans. Le bonhomme, devenu ainsi doublement
Canadien, est charmé de voir un Français de la vieille France ; il veut en
conserver le souvenir, et je lui laisse mon nom en échange du sien ; si sa
maison était une auberge, j’aimerais à y prendre gîte pour la nuit ; cela me
procurerait quelque agréable causerie sur la baie d’Hudson, la rivière Rouge,
les Esquimaux, les bois brûlés et toute la fantasmagorie des chasses du Nord ;
mais l’heure presse et le relais est loin.
Adieu,
lui dis-je, père Bellie ; je vous quitte vraiment à regret, car il me semble
que j’aurais causé avec vous jusqu’à demain sans me fatiguer. Grand et fort
comme vous êtes, vous devez avoir eu de terribles combats à la baie ; elle a
été attaquée si souvent ! — Non, monsieur, on n’en a eu qu’un, mais, dame, il a
été dur. — Oh ! Contez-moi donc cela. —Volontiers, ce n’est pas long. Vous avez
dû entendre parler de Lord Selkirk qui fonda une compagnie rivale de la nôtre
et voulut nous déposséder par force ; on marcha contre lui et il y eut de
sanglantes rencontres. Un jour je m’étais avancé sur son territoire avec deux
camarades ; nous avions résolu de faire coup sur la maison d’un chasseur qui
passait pour très redoutable ; il s’agissait de la surprendre la nuit et d’exterminer
les habitants. On fit heureusement les approches en rampant, et l’on jeta le
cri de guerre dès que le premier flambeau s’alluma. La vivacité de cette
irruption fit croire au chasseur que nous étions plus nombreux et il s’échappa
avec sa femme en appelant ses enfants qui étaient déjà couchés. Mes deux
camarades pour s’exciter au combat avaient bu beaucoup de gin ; dans leur
fureur ils se jetèrent sur les enfants et les massacrèrent. Ce spectacle me
glaça d’horreur, et quand je vis une jeune fille, attirée par les cris de ces
malheureux enfants, sortir d’une chambre où elle s’était cachée pour les
couvrir de son corps, je me trouvai saisi de confusion. —Eh bien, tue-la donc,
me crièrent mes camarades. —Moi ? Jamais !, répondis-je. —Alors ce sera moi,
répliqua le plus ivre des deux, et ce ne sera long : tiens, ajouta-t-il en
levant son sabre, et il porta plusieurs coups que j’écartai avec le canon de
mon fusil. — Ah ! c’est cela ! s’écria-t-il, tu vas me le payer. Et il me
porta un coup furieux sur la tête que je n’esquivai qu’en partie, mais
l’ajustant aussitôt en pleine poitrine, je l’étendis mort sur la place. En le
voyant tomber l’autre camarade exaspéré me tira un coup de fusil et, m’ayant
manqué, se jeta sur moi avec son sabre. Les coups étaient aussi vifs que
terribles, je fus touché au bras, mais dans un effort suprême je l’atteignis au
côté et le perçai de part en part. Alors je relevai la jeune fille qui était
sans connaissance, et après l’avoir ranimée je la ramenai pleurante au camp.
—Dieu soit loué ! Et qu’est-elle devenue la pauvre enfant ! —Elle est devenue
ma femme. Tenez, c’est elle qui file dans ce coin. La vieille avait posé son
fuseau pendant ce récit. —Oui, dit-elle, c’est moi ; mais il oublie de vous
faire connaître qu’il fut gravement blessé dans cet affreux combat, et qu’il
garda le lit deux années entières. —Oui, deux années entières pendant
lesquelles je ne fus soigné que par toi.
Cette
scène m’émut à un tel point que je ne pouvais plus me déterminer à quitter ces
braves gens. Il le fallut cependant ; notre sleigh
avait été remis en ordre et le charretier debout devant la porte faisait
claquer son fouet pour nous appeler.
Il
y a au centre de la paroisse de Sainte-Anne une petite auberge tenue par un
nommé Lecours ; elle est voisine de l’église et peu éloignée de la maison
seigneuriale. L’hôte, en sa qualité de courrier de la malle, est toujours
absent ; l’hôtesse, petite femme alerte et dégagée, fait de son mieux pour
qu’on ne s’en aperçoive pas. Native d'Yamachiche, elle a poussé ses voyages
jusqu’à la Rivière-du-Loup (Louiseville), et elle a fait le service des bains
thermaux de Saint-Léon, ce qui l’a initiée à tout ce qu’exige le soin des grandes
dames. Étrangère à sa nouvelle résidence, il lui est impossible de nous donner
aucun renseignement ; elle sait seulement, et elle répète sans cesse que le
seigneur est très aimé. C’est une particularité dont je prends note. Comment ce
monsieur fait-il ? A-t-il renoncé à ses redevances ? A-t-il abandonné les lods
et ventes ? Ses moulins ne sont-ils plus sous le monopole de la banalité ? Être
généreux, faire d’abondantes aumônes, accorder des délais, secourir même les
censitaires en retard, tout cela n’aboutit généralement qu’à faire des ingrats
ou des paresseux. L’heureuse exception que l’on me signale a donc besoin d’être
expliquée ; c’est une énigme pour moi. Jusqu’ici, je n’ai exercé aucune
poursuite, j’ai donné du temps à tous les retardataires, je me suis prêté
complaisamment à tous les arrangements qui m’ont été proposés ; je me suis
laissé voler, piller à miséricorde et merci, et mes honnêtes campagnards n’ont
vu en moi qu’une dupe ; ils ont ri de la faiblesse ou de la niaiserie qu’ils m’ont
attribuées ; il n’est venu à la pensée d’aucun d’eux qu’il pût entrer un seul
grain de bonté dans tous ces actes débonnaires ; il est vrai que je suis
Français ; le moyen d’être aimé par des Anglais, des Écossais et des
Américains, ce serait contre nature.
Notre
auberge est du genre le plus rustique. La première pièce, dans laquelle se
tient la famille avec le commun des voyageurs, sert à une variété infinie
d’occupations de ménage ; on lave, on y repasse, on y boit, on y mange, on y
fume ; un poêle omnibus est consacré à tous les usages possibles ; il est
chauffé à rouge, ce qui établit entre la première pièce et la seconde une
différence de neuf degrés, quoique cette dernière soit également chauffée par
un poêle ; on nous a servi sous le titre de souper un repas composé de deux
pièces froides et de thé vert, alliance aussi malheureuse pour l’estomac que
pour les nerfs. Nous avons assuré notre sommeil en recourant à notre réserve de
thé noir ; avec cela et quelques sandwichs, on ne s’expose ni à l’insomnie ni
au cauchemar.
On
nous a demandé si nous n’avions pas d’objection pour laisser venir à notre
table un marchand voyageur ; nous avons agréé l’introduction, et un homme grand
et carré à figure d’Antinoüs auvergnat a pris place auprès de nous. Les
systèmes de nourriture et d’hygiène diffèrent essentiellement d'un pays à
l’autre. Notre commensal nous en a donné une nouvelle preuve en arrosant d’une
cataracte de thé vert des tranches à demi pétrifiées de mouton et de porc. Il a
mangé de tout, et plusieurs fois, sans paraître éprouver autre chose qu’une
sensation agréable. Quel appétit vigoureux ! C’est à faire envie à tous les
gourmands. Nous avons parlé commerce. Notre homme m’a dit qu’il recueillait du
grain dans les paroisses voisines et qu’il le portait à Boston et à New-York.
Cette opération, dont les détails exigent de l’intelligence et de l’activité,
lui donne d’assez beaux bénéfices ; il ne spécule cependant que sur une légère
différence dans les cours des marchés canadien et américain ; mais cette
différence, quelque faible qu’en soit le chiffre, promet un commerce important,
lorsque la réciprocité faisant disparaître tout droit de douane, y ajoutera le
montant de la taxe actuelle. Je n’attendais pas tant d’esprit d'entreprise de
la part d’un ancien Acadien, habitant cette paroisse enténébrée de
Saint-Grégoire qui ne veut pas d’écoles. Notre commensal s’est informé auprès
de moi de ce qu’on pouvait faire en Californie ; c’est la question que l’on m’adresse
partout ; chaque village a fourni son contingent ; un navire vient de partir de
Québec, chargé d’Argonautes canadiens ; les présents et les vœux de tout le
pays n’ont cessé qu’au moment où l’on a mis à la voile. L’or ne sera donc
jamais une chimère, en dépit du refrain de Robert le Diable.
J’ai
répondu au consultant : « Mon ami, je ne suis pas allé en Californie et je n’ai
aucune intention d’y aller; je n ai donc aucun renseignement particulier à vous
donner ; tout ce que je sais, c’est que peu de fortunes se feront en fouillant
les gîtes, dépôts aurifères ; qu’on y compromettra sa santé et sa vie, et qu’il
faudra souvent donner d’une main ce qu’on trouvera de 1’autre pour le logement,
la nourriture, le vêtement et l’hivernage de la morte saison, tandis qu’avec le
commerce on pourra s’enrichir promptement et sans danger. Or, vous êtes
commerçant, et commerce pour commerce, il me semble qu’il vaut mieux faire des
affaires à votre porte qu’à tant de mille milles de chez vous ; le capital seul
que vous aurez à dépenser pour vous rendre à San Francisco est ici un élément
suffisant de succès, et quand le traité de réciprocité abaissera la barrière du
tarif, vos bénéfices doubleront ou tripleront, ce qui vous permettra de doubler
ou tripler vos opérations. Gardez-vous donc encore une fois d’aller chercher la
Californie si loin et à si grand coût, elle est sous votre main, et elle ne
vous demande aucune avance ». —Mon Acadien m’a écouté très attentivement, mais
je ne me flatte pas de l’avoir convaincu ; si je voyais son nom sur la première
liste d’émigrants, je ne serais pas surpris. Quand cette race a une idée dans
la tête, elle y est fixée comme un clou : plus on frappe dessus, plus elle
s’enfonce.
12 janvier. Samedi.
La
nuit s’est assez bien passée. Le thermomètre ne marquait que dix degrés Réaumur
au-dessous de zéro quand nous nous sommes disposés à continuer notre voyage.
N’ayant fait que deux relais hier, il faudrait en faire quatre aujourd’hui pour
rétablir la balance et arriver au quitus ; mais on s’est levé tard, le temps
n’est pas beau, et la route est mauvaise. On nous signale deux autres obstacles
: la longueur du relais des Écureuils et la fondrière de la Petite-Suède.
Pendant qu’on attelle les chevaux à notre sleigh,
nous courons visiter l’église de Sainte-Anne ; elle ne nous offre rien de
remarquable ; son architecture est la même que dans toutes les églises de campagne
bâties du temps des missionnaires jésuites ; elle ne se distingue que par le
travail de ses sculptures sur bois et par l’ornementation du maître-autel. Les
dorures ternies et presque effacées indiquent une durée déjà longue.
La
rivière Sainte-Anne, dont l’embouchure est proche de l’église, figure au rang
des plus beaux affluents du Nord ; un pont, justement renommé, comble une des
plus larges lacunes de la route de poste.
Partis
de notre auberge un peu après dix heures, nous cheminons péniblement jusqu’à
Deschambault ; la rive du Saint-Laurent a pris les proportions d’une falaise,
et cette crête ravinée de distance en distance n’est qu’une succession de
montées et de descentes. Le ciel couvert et brumeux ne nous envoie aucun
sourire ; nous ne pouvons apprécier que par un effort d’imagination ce que doit
être la seigneurie de Sainte-Anne dans la fraîcheur de sa verdure printanière
et sous les rayons d’un beau soleil.
Nous
devions descendre chez Langevin à Deschambault ; on nous a conduits chez
Marcotte, et il s’est fait là un petit tour de passe-passe auquel nous aurions
dû nous opposer. Au lieu d’un extra
on nous a donné une diligence à quatre places, voiture plus lourde et plus
lente et qui, d’ailleurs, déclassait l’ordre des prix. M. Marcotte s’était
montré si empressé, si poli, il nous avait fait servir un si bon potage, il
nous avait si parfaitement dégelés que notre reconnaissance a étouffé toute
plainte. La route si tourmentée de Sainte-Anne à Deschambault demandait des
chevaux frais et dispos ; or, qu’est-il arrivé ? À peine avions-nous fait une
lieue, que nous avons rencontré la malle-poste, et le charretier de cette
dernière voulant revenir à son relais, a proposé au nôtre un échange de chevaux
qui a été fait sans qu’on nous ait même consultés. La conséquence de ceci,
c’est que les mêmes chevaux qui venaient déjà de faire quatre lieues en ont eu
encore quatre à faire, tandis que les nôtres n’en auraient eu que cinq en tout
; aussi, il fallait voir les pauvres bêtes lorsqu’elles sont arrivées à
Deschambault ; la sueur ruisselait sur leur corps et s’y transformait en
pendeloques de givre, tandis que leurs naseaux lançaient des jets de fumée
comme les tubes bouilleurs des locomotives.
De
Deschambault à Québec, la rive du Saint-Laurent, escarpée et brisée, s’élève
avec raideur, et ne s’abaisse ça et là que pour remonter bientôt par une pente
plus abrupte ; c’est une chaîne dont le Cap Diamant forme le dernier anneau.
Les sites les plus pittoresques se trouvent au Cap Santé et à Jacques-Cartier.
Cap-Santé est renommé pour son bon air ; on y domine le fleuve et l’on y est
abrité des vents du nord par un rempart de montagnes boisées ; l’église, que
nous avons visitée en passant il y a deux ans, est vaste et propre ; nous avons
remarqué sur les murs quelques tableaux modernes d’une médiocrité vulgaire ; le
presbytère, bâti sur le même plateau du cap dans une situation ravissante,
s’annonce avec une élégance qui tient du luxe. La seigneurie était la propriété
des Ursulines de Québec en 1760, et l’on y comptait déjà 63 familles qui
fournissaient un contingent d’hommes pour la milice.
 |
| L'église de la Sainte-Famille, à Cap-Santé, a été construite entre 1754 et 1767. Elle a été visitée par Adolphe de Puibusque et son épouse Élisa Taylor lors de leur passage deux ans avant leur périple hivernal entre Montréal et Québec, durant lequel ils traversèrent de nouveau ce village pittoresque. (Source : Wikipedia ; cliquer sur l'image pour l'agrandir) |
Des
pêcheries d’hiver sont établies sur le Saint-Laurent dans tout le bordage de
glace attenant à la rive gauche. On pratique des trous dans la glace et on y
plonge des nasses dormantes ou volantes qui se remplissent, soit avec le flux,
soit avec le reflux selon les diverses espèces de poissons : c’est un assez
rude métier ; les bénéfices sont incertains et variables ; les pêcheurs, trop éloignés
du rivage pour aller et venir sans cesse, élèvent des maisonnettes de bois dans
lesquelles ils passent une partie du jour et quelquefois de la nuit ; ils
allument devant leur porte de grands feux sur la glace. Il leur serait
difficile de s’établir d’une manière permanente et commode, parce que la marée,
qui les soulève chaque jour et les fait retomber de six à dix pieds, a de
fâcheux caprices ; elle fait des crevasses dans les parties qui semblent prises
avec le plus de solidité et dresse tout à coup en forme d’obélisques ou de
colonnes d’immenses glaçons là où tout était uni comme un miroir.
Cap-Santé
m’avait ravi ; mais à Jacques-Cartier l’étonnement a augmenté le charme ; entre
deux côtes élevées, la rivière s’est ouvert une route pour se jeter dans le
Saint-Laurent, et, de son côté, ce fleuve a creusé une baie circulaire dans
laquelle l’industrie a établi des usines. On se figure aisément ce que doit
être cette baie en été ; mais l’imagination n’indiquerait pas ce qu’elle est en
hiver ; il faut la voir avec son tapis blanc, ses groupes d’arbres verts
argentés de neige et diamantés de givre, ses moulins, ses cottages et son pont.
Notre sleigh s’est précipité
bravement dans la spirale dont la dernière sinuosité est au fond de l’anse ; il
a tourné avec adresse sur le pont, qui n’est ni long ni large ; mais en
remontant la rampe escarpée de l’autre bord, l’hésitation d’un cheval a fait
décliner et nous avons failli tous descendre à reculons. Élisa effrayée s’est
élancée dehors et s’est enneigée jusqu’à la poitrine ; moi je n’ai pas bougé et
je suis arrivé sain et sauf au sommet de la côte.
 |
| Le pont sur la rivière Jacques-Cartier, près de Cap-Santé, tel qu'il paraissait à l'époque où Adolphe de Puibusque le traversa durant son périple hivernal de Montréal à Québec. Aquarelle de George Heriot, début du 19e siècle. (Source : BANQ) |
Parvenus
une fois encore sur le plateau des caps, nous avons traversé une grande et
belle sucrerie. Les hautes futaies laissent des clairières où la neige s’amoncelle
et où elle produit des effets bizarres. Des arbres, coupés par la hache ou
brisés par le vent, peuplent cette froide solitude de fantômes silencieux
enveloppés dans leurs linceuls. Je remarquai un érable couché horizontalement
sur un groupe de cèdres verts ; la neige y avait trouvé un point un appui et,
couvrant du haut en bas une ligne inclinée, elle avait formé un pont aérien. Il
est impossible de traverser sans recueillement une forêt remplie de ces
décorations sépulcrales ou plutôt toute pleine de spectres debout ou
agenouillés sur leurs sépulcres entrouverts : ce n’est pas l’hiver, c’est la
mort que l’on croit voir de tous côtés.
La
rivière Jacques-Cartier ne nous était pas inconnue, nous l’avions passée en
allant au lac Saint-Joseph, et nous n’avions oublié ni la rapidité de son
cours, ni l’escarpement de ses bords, ni la végétation luxuriante qui
l’environne. Plusieurs pêcheries de saumons y étaient en grand renom autrefois
; on les a laissé tomber, je ne sais pourquoi. Son embouchure dans le Saint-Laurent
a cela de remarquable que la rive droite se relève en talus ou parapet et forme
une redoute naturelle. Voilà pourquoi, après la fatale bataille livrée le 13 septembre 1759 sur les plaines d’Abraham, le chevalier de Lévis y rallia
l’armée et s’y retrancha : c’est à l’ombre de cette forêt vénérable qu’il
médita la glorieuse revanche prise le 28 avril 1760, attaque hardie, retour
héroïque, dernier adieu des Français à la victoire dans ce Canada qu’ils avaient
découvert, conquis et colonisé. Ici, sur cette rampe où nous glissons
maintenant se tenaient les vedettes ; à droite et à gauche, dans le bois, étaient
les tentes du camp ; des sentinelles avancées veillaient sur toutes les pointes
des rochers qui avancent sur le Saint-Laurent ou la Jacques-Cartier. À chaque
heure on entendait courir ce cri sur les deux rivages : « Sentinelle, garde à
vous ! » et le qui-vive des patrouilles retentissait d’échos en échos.
Languedoc, Béarn, Guyenne, tous ces braves enfants de notre Midi, riaient,
chantaient autour des feux de bivouac les pieds enfoncés dans la neige,
mangeant leur morceau de cheval fumé, buvant leur cidre aigri, déchirant à
belles dents les vertus de l’intendant Bigot et du munitionnaire Cadet. Que de
jeux de mots sur la Friponne, cette
honnête maison de recel où les agents faisaient entrer chaque jour par un
souterrain tout ce qu’ils dérobaient dans les magasins royaux pour le revendre
le lendemain au roi.
Oh
! Si les échos de ce bois pouvaient redire tout ce qu’ils ont entendu ! Mais
non ; pas un mot, pas un son, —rien, rien. Partout le silence de la mort. De
ces intrépides bataillons, de ces dignes aïeux des martyrs de la Bérézina, que
reste-t-il ? Le peu que l’histoire a conservé lorsque l’histoire a été
reconnaissante et juste.
La bataille du 28 avril 1760, qui fut si brillante pour nos armes, aurait été décisive, c’est-à-dire qu’elle nous aurait rendu avec la citadelle de Québec la possession de tout le Canada, sans un incident qui divulgua notre marche à l’ennemi. C’était à l’époque de la débâcle du Saint-Laurent ; un chaland rempli d’artilleurs heurta si rudement un glaçon flottant qu’un canonnier tomba dessus et fut emporté dans le cours du fleuve ; bientôt le froid le saisit et il perdit connaissance. C’est dans cet état qu’il passait devant Québec lorsqu’il fut aperçu et on envoya un bateau à sa rencontre. Rapporté dans la ville, il dut aux soins qui lui furent donnés de reprendre ses sens ; se croyant entouré de Français, il révéla la marche de l’armée et mourut aussitôt. Le général Murray averti évita une surprise, il marcha le lendemain au-devant de l’ennemi ; mais il fut battu et n’eut que le temps de se rejeter dans la place, qui faillit être prise. On cite une maison près d’un moulin que nos grenadiers forcèrent à la baïonnette et d’où les Highlanders furent délogés plusieurs fois. De part et d’autre on y fit des prodiges de valeur, mais il fallut attaquer la ville de Québec avec des moyens de siège insuffisants, et dès lors il devint certain qu’elle serait au premier qui recevrait du secours par mer. Tous les yeux étaient fixés sur le Saint-Laurent ; par malheur, la première flotte qui arriva fut une flotte anglaise ; elle délivra la garnison bloquée et menaça les derrières de l’armée française, qu’elle obligea à lever le siège et finalement à battre en retraite. Avançons, avançons ; le passé a déposé ici trop de souvenirs de deuil.
 |
| Vue arienne du site du fort Jacques-Cartier, où le chevalier de Lévis se replia avec ses troupes au lendemain de la bataille des plaines d'Abraham, et qu'Adolphe de Puibusque décrit dans le récit de son voyage hivernal entre Montréal et Québec. (Source : Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française) |
Vers quatre heures, nous atteignons le relais des Écureux [près de Donnacona] ; les chemins les plus pittoresques, étant les plus accidentés, sont nécessairement les plus difficiles et par suite les plus longs à parcourir. Ce raisonnement est d’une naïveté telle que je crois l’avoir volé aux chevaux qui viennent de nous mener ; les malheureux ! Ils ont bien gagné l’avoine qu’ils n’auront peut-être pas. La poste suivante est moins rude, dit-on, mais elle a plus de six lieues ; on relaie à la grande Lorette ; n’importe, nous sommes déterminés à pousser en avant. La température est douce, et le froid peut reprendre demain avec une intensité qui nous arrête.
Pour
accélérer le changement des chevaux, nous ne quittons pas même notre sleigh ; la nuit menace d’être sombre,
mais nous comptons, à défaut de la lumière du ciel, sur la lumière de la terre
; la blancheur de la neige éclairera notre conducteur. D’ailleurs, comme j’en
ai déjà fait l’observation, les habitations sont si rapprochées qu’elles
forment une sorte de rue, et de chaque maison sort la clarté d’un fanal pour
nous guider. Les Écureux ou Écureuils forment une seigneurie qui, au moment où
nous avons perdu le Canada, appartenait au seigneur Jean-Baptiste Dussault ; on
y comptait 52 feux qui pouvaient fournir 70 miliciens. Quoique le front de la
paroisse sur le Saint-Laurent ne fût que d’une demi-lieue, il y avait six
pêcheries, dont trois au moins d’anguilles.
La
seigneurie suivante a un front cinq fois plus étendu ; deux lieues trois quarts
sur quatre lieues de profondeur ; elle porte le nom de Seigneurie de Neuville ;
en 1760, elle avait déjà changé trois fois de mains, passant de M. de Dombourg
à M. Dupont, et de M. Dupont à madame de Méloize ; il y avait 104 feux qui
donnaient 130 hommes en état de porter les armes.
Un
voyage nocturne arrivait à propos pour compléter nos observations ; c’était un
nouveau spectacle plus triste, mais plus saisissant que tous les autres. Après
une courte halte à Saint-Augustin pour laisser souiller les chevaux, nous avons
continué la route au milieu d’une brume glacée, dont l’humidité nous pénétrait.
Saint-Augustin, paroisse florissante, un des principaux greniers d’abondance de
Québec, est une colonie de réfugiés acadiens. Les Desroches y sont nombreux.
J’ai eu par malheur à demander des renseignements généalogiques sur l’un deux,
et tous aussitôt se sont figuré que j’étais un oncle d’Europe en quête d’un
héritier. On a parlé d’une succession californienne et, depuis lors, j’ai eu
beau dire et écrire qu’aucun intérêt d’argent n’était mêlé à mes recherches,
tous ces Desroches ont persisté à rêver une fortune dissimulée. Plus je nie,
plus ils croient.
Saint-Augustin a deux lieues et demie de front sur le fleuve et une lieue et demie de profondeur. En 1760, quoique le nombre de feux n’excédât pas 96, on comptait 155 miliciens. La seigneurie appartenait et appartient encore à l’Hôtel-Dieu de Québec.
En
été, on peut suivre les caps ou bords de l’eau jusqu’à Québec ; mais dans cette
saison, on fait un détour à partir de Saint-Augustin pour éviter plusieurs pas
difficiles et surtout les ravins du Cap Rouge. À neuf heures, nous étions à la
Vieille-Lorette. Notre charretier, trompé par notre voiture à quatre places et
croyant mener le stage, nous a
conduits au relais au lieu de nous conduire à l’auberge. Là, il n’y avait à peu
près que les quatre murs, et dans cette nudité deux pauvres Irlandais de quinze
à dix-huit ans qui ont offert de nous céder un lit dont la vue seule nous
aurait guéris de toute envie de dormir. Encore si quelque fauteuil, quelque
chaise longue nous eût assuré un refuge ; mais nous n’avions d’autre ressource
que de nous coucher sur nos fourrures. Tandis qu’on les étendait à terre, j’ai
questionné le charretier, et ce rustre s’est décidé à m’apprendre qu’à cent pas
ou moins il y avait une bonne auberge. Voyez ce que c’est : faute
d’explication, nous allions jeûner, veiller et geler à quelques toises d’une
maison où nous pouvions trouver bonne table, bon feu et bon lit ; les chevaux
on été rattelés, et on nous a transportés en trois minutes dans un petit hôtel
de campagne où nous avons trouvé tout ce qui nous manquait outre une aubergiste
introuvable.
La
mère G***, écartant avec fierté l’incognito que lui infligent son nom et sa
profession, nous a confié qu’elle descend en ligne directe du fondateur de
Québec. Voici comment cette révélation est venue : on parlait de café ; on
aurait parlé d’allumettes chimiques ou d’eau Raspail que la transition serait
arrivée aussi naturellement. —Du café ! Ah ! certes, je sais en faire de bon en le clarifiant avec des œufs ;
c’est que, voyez-vous, le père de mon grand-père était Français ; c’est lui qui
a découvert le Canada avec Jacques Cartier. —Vraiment ! Et quel était son nom ?
—Monsieur de Champlain. —Vous êtes une Champlain ? —Oui, monsieur. —Je vous en
félicite. Êtes-vous parente des Champlain des Trois-Rivières ? —Non, Dieu merci
! Ce ne sont pas de vrais Champlain ; nous seuls sommes les bons. — Mais
qu’avez-vous fait de vos seigneuries ? —Je ne sais pas ce que c’est devenu; on
avait toutes les terres jusqu’au Saguenay, trente lieues de front sur la rive
nord du Saint-Laurent ; il paraît qu’elles ont été prises. —Du moins, votre
auberge vous reste. —Oui, monsieur, et je puis dire qu’il n’y vient que du beau
monde.
Et
là-dessus, elle nous a cité tous les ivrognes les plus respectables de Québec.
Voisine du champ de course, elle voit la plupart des paris s’engager sous son
toit autour des tables chargées de bouteilles. Je n’ai pas besoin de remarquer
que cette ex-cuisinière m’a servi, sous forme de généalogie, un plat
d’anachronismes un peu trop épicé ; elle a supprimé les cinquante ou soixante
ans qui séparent Jacques Cartier de Samuel Champlain, et elle a introduit
l’usage du café quelque trente ou quarante ans avant l’époque où la marquise de
Sévigné le signalait comme une nouvelle mode qui devait bientôt passer avec le
goût du théâtre de Racine. En outre, Champlain, pour être le père de son grand-père
aurait dû vivre jusqu’au milieu du dix-huitième siècle, et il est mort en 1635,
ce qui lui enlève environ 110 ans de la vie à la Mathusalem qu’elle lui a si
libéralement accordée. Bagatelles que ces petites méprises-là.
Mais
voici qui est grave. La descendante de M. de Champlain ayant prétendu que dans
son jeune temps elle avait brillé à Québec dans le même art que le chef
(cuisinier) de son illustre aïeul, nous avons cru, néanmoins, qu’il serait
indélicat de faire appel à un talent rouillé par l’absence de tout exercice, et
nous avons poussé la discrétion jusqu’à ne lui demander qu’une simple omelette.
On a mis le couvert, et nous avons entendu beaucoup d’agitation dans la pièce
voisine ; il semblait qu’on criait au secours. L’omelette s’est longtemps fait
attendre. Enfin, la nièce de notre cordon bleu s’est écriée en posant le plat
sur la table : « Ah ! Si vous saviez comme ma tante a eu de la misère pour
virer et revirer son omelette ». L’auteur s’est montrée alors pour recevoir nos
compliments la figure en feu et la sueur sur le front ; quoique son omelette ne
fût omelette ni pour le fond ni pour la forme, c’était quelque autre chose qui
pouvait se manger : en voyage, on ne tient pas aux étiquettes.
Si
le père Chiniquy, le missionnaire de la tempérance qui fait tant de
conversions, eût été avec nous, il aurait pu faire récolte d’histoires
tragiques pour illustrer ses sermons. Un certain Duff s’est tué dans cette
auberge à coups de brandy, et sa mort a été mise sur le compte du choléra. Un
autre ivrogne, dont la mère G*** craignait d’avoir à payer l’enterrement, a été
congédié lorsqu’elle l’a réputé incurable. Revenu à Québec, il a fait élection
de barre à l’hôtel d’Albion, et a
commencé avec le maître même de l’hôtel un duel de bouteilles qui s’est terminé
par un coup fourré ; les deux champions sont restés sur le carreau ; on les a
portés en terre le même jour. Au pied de cette côte qui mène à l’Ancienne-Lorette, dont nous apercevons d’ici le clocher, un ivrogne de la campagne s’est
enneigé à la brune, en revenant de la ville, et le lendemain matin on l’a
trouvé mort à côté de son cheval, gelé comme lui ; les pieux de la traîne s’élevaient
seuls au-dessus de cette tombe glacée, comme pour demander secours.
13 janvier. —Dimanche.
Thermomètre
à sept heures du matin : quinze degrés Réaumur au-dessous de zéro; —ciel pur,
—vent nord-est. Évidemment, nous avons bien fait de prendre gîte pour la nuit
et surtout dans une maison suffisamment chauffée.
À
déjeuner, la mère G*** nous a servi du café à la Champlain ; les derniers œufs
de la maison y avaient passé. Tout en le prenant, nous avons pu voir le défilé
des habitants et habitantes qui se rendent à l’église. Aucune distance, aucun
froid ne les arrête. Il y a peu de variété dans les costumes ; la toilette des
femmes se compose de capotes noires ouatées et piquées ou de chapeaux de
fourrure teinte de couleur rousse ou grise, de gros manteaux de drap à
plusieurs collets, ancienne forme de carricks,
de voiles verts doubles ; le reste, enchâssé dans les voitures, est invisible ;
il y en a qui sont dans des carrioles, d’autres dans de simples caisses où
elles s’emballent comme des objets fragiles. Les hommes sont tous vêtus
d’étoffe du pays, espèce de drap gris de fer, et portent des ceintures rouges ;
le chapeau de feutre noir remplace la tuque bleue de la semaine, et ils portent
aux pieds d’énormes mocassins de cuir jaune.
À
neuf heures et demie, nous nous disposons à partir. Rien de plus facile. À
notre arrivée, la mère G*** nous avait dit : « Vous pouvez quitter tout votre butin
dans la carriole ; nous avons un hangar qui ferme à clef et où peuvent entrer
les voitures toutes rondes. Quand
vous serez parés pour embarquer, vous trouverez tout à la même endroit ».
En
effet il a suffi de s’y transporter ; les chevaux ont été attelés et on s’est
mis en route pour Québec ; on nous a promis de nous y conduire en moins de deux
heures ; il n’y a que trois lieues; mais il faut traverser la Suède. C’est un
bas-fond qui se trouve au pied du grand plateau des Plaines d’Abraham, sous
Sainte-Foy. Quand le vent souffle de l’est, il balaie tout le plateau, et la
neige s’abat par tourbillons sur la Suède. Dans la route entière il n’y a pas
de plus mauvaise place ; grâce aux nombreux accidents de ces derniers jours, la
herse, la pioche et la pelle ont tant et si bien travaillé qu’elles ont fait
brèche ; nous n’avons pas enneigé ; le vent, d’ailleurs, avait tourné ; il
venait du sud-ouest, nous l’avions à dos, et c’est à peine si nous sentions le
froid, quoiqu’il fût à 14 degrés. Une fois sur le plateau tout est dit ; on
glisse divinement.
Les
maisons de campagne de la route Sainte-Foy, si jolies et si coquettes en été,
présentent un aspect sévère ; plusieurs sont bloquées par la neige ; on ne voit
pas une seule clôture ; les pieux ne sont indiqués que par des rangées de
petits points noirs ; nous avons remarqué une haie vive changée en massif; un
ciment de neige en a fait une muraille parfaitement droite et unie.
Nous
avons admiré encore une fois l’effet de la lumière sur les arbres enduits de
givre. Le soleil, caché depuis deux jours, a reparu soudain pour semer des
diamants, des rubis, des émeraudes sous les reflets de tous ses rayons ; la
moindre branche, doublée du côté du nord d’une longue écorce de cristal,
étincelait des feux changeants du prisme ; c’était éblouissant.
À midi, nous entrions à Québec ; on sortait des églises, et une file de sleighs de maîtres se croisait avec nous ; c’était le cortège de ville après le cortège de campagne. Nous nous sommes retirés chez M. Russell qui tient l’ancien hôtel de l’Union, aujourd’hui de Saint-Georges, sur la Place d’Armes. M. Faribault, notre obligeant ami, avait retenu pour nous trois grandes pièces au rez-de-chaussée ; le prix de notre pension tout compris, avec le service en privé, est de 20 livres par mois, environ 550 francs. Je m’arrête à ce détail d’argent, commencement et fin de toute chose dans l’Amérique du Nord.
14 janvier. —Lundi.
Hier
je disais : « Je m’arrête ». Et aujourd’hui je continue. C’est que mon arrivée
a été célébrée par un pique-nique que je crois devoir servir comme supplément.
Dès
le matin, mon ami M. Faribault est entré chez moi et m’a dit : —Notre petite
société a décidé qu’elle vous offrirait aujourd’hui une partie aux Chutes de Montmorency et que l’on dînerait avec vous dans l’île d’Orléans. Je suis son
envoyé auprès de vous et j’espère bien que vous ne me ferez pas faire une
mauvaise ambassade. —Non certes, j’accepte, je serai des vôtres, mais à quelle
heure ? —Onze heures. —Soit, j’y consens.
Et à onze heures très précises, un sleigh était devant ma porte, j’y
prenais place avec Élisa, et fouette cocher ! Nous étions une vingtaine, ce qui
formait un assez joli cortège. L’effet en était curieux sur le Saint-Laurent ;
il y avait tant de cahots qu’un sleigh
était en l’air quand le suivant était en bas ; on eût cru voir des barques
ballottées par la houle. Les femmes jetaient des cris qui se mêlaient aux
éclats de rire des hommes, et le voyage fut très gai jusqu’aux Chutes de
Montmorency. La rivière de ce nom arrive du nord sur un lit schisteux ; après
avoir franchi un espace rempli de longs bancs de pierres horizontales qu’on
appelle les Marches naturelles, elle rencontre une solution de continuité et se
précipite dans le Saint-Laurent d’une hauteur d’environ 250 pieds.
Cette
chute, vue du Saint-Laurent où nous étions, est d’une beauté incomparable ;
elle excède de cent pieds celle du Niagara ; mais elle ne se compose que d’une
masse qui tombe droit devant elle ; des pierres anguleuses qui forment
plusieurs saillies coupent seules cette masse et opèrent un rejaillissement.
Goutte à goutte l’eau s’accumule à une certaine distance, y gèle et s’élève en pain de sucre ou cône d’une hauteur qui varie chaque année de 130 à 150 pieds. Ce
cône est aussi poli que s’il avait été fait de main d’homme ; c’est un chef-d’œuvre
unique au Canada, dans toute l’Amérique et dans tout le monde entier.
Des
marches y ont été creusées avec la hache ; on monte jusqu’au sommet et de là on
se précipite sur des clisses de bois tête en avant. J’avoue que je fus effrayé
de la rapidité des chutes et que je ne me sentis aucune envie de les imiter ;
mais il y a un second cône formé des gouttes d’eau qui ne s’arrêtent pas au
premier ; il n’a guère qu’une vingtaine de pieds et cela m’a paru assez haut
pour nous : j’en ai fait plusieurs chutes qui m’ont porté à une demi-lieue sur
une plaine de glace ; un enfant s’était placé devant nous sur la clisse et la
dirigeait. On n’entendait de tous côtés que des cris joyeux ; le spectacle
était sublime et charmant.
Autour
des Chutes de Montmorency, des masses de glace pendaient comme d’énormes cristaux
; toute la baie formée par le Saint-Laurent était gelée et couverte d’une neige
éblouissante sur laquelle la foule mouvait ses petits points noirs ; une file
gravissait un côté du grand cône, tandis que du côté opposé, on voyait les glissades
se succéder : c’était un mouvement perpétuel.
 |
| Le pain de sucre, ou cône de glace, tel que représenté par le graveur sur bois français Noël-Eugène Sotain (1816-1874), d'après le récit d'Adolphe de Puibusque. Cette gravure a d'abord été publiée en 1861 dans le Courrier des familles, à Paris. (Source : Journal de l'Instruction publique, Montréal, mars 1862 ; cliquer sur l'image pour l'agrandir) |
Nous
n’avons quitté qu’à regret cette grande et belle scène pour nous rendre par le
Saint-Laurent à une des cinq paroisses de l’île d’Orléans. Un dîner rustique
nous attendait chez un habitant du nom de Gagnon. Nous avons trouvé ce brave
homme achevant de sculpter un candélabre en bois pour son église ; il est
menuisier, serrurier, charron, tisserand, un peu de tout enfin, comme les
colons français du Canada, et sa femme, soit dit sans rancune, est beaucoup
supérieure pour la cuisine à la mère G***. Elle a une nombreuse famille, parmi
laquelle j ai remarqué un petit brunet qui suivait tous les détails de notre
dîner avec une extrême curiosité ; je l’ai invité à en prendre sa part et il ne
s’est pas trop fait prier.
Le repas a été d’une gaieté canadienne, on a lancé des toasts étourdissants, on a chanté au dessert et l’on n’a quitté la table que pour reprendre avec de nouvelles plaisanteries la route de Québec, où l’on n’est rentré qu’à la clarté des lanternes. Ma pauvre femme était ravie, mais bien fatiguée.
Journal de l'Instruction publique, Montréal, numéros de janvier, février et mars 1862.


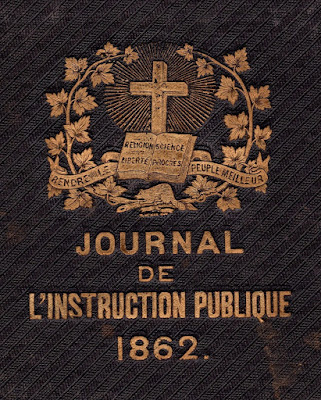





Passionnant. Merci!
RépondreSupprimerVraiment intéressant!
RépondreSupprimerTres interressant.. Merci beaucoup d'avoir partage.
RépondreSupprimerTrès intéressant.
RépondreSupprimerComme si j'y étais, j'ai adoré !
RépondreSupprimerTrès intéressant. Merci.
RépondreSupprimerVraiment passionnant! J'ai adoré la lecture et j'en ai fait mention dans un cours avec mes jeunes du secondaire à l'école secondaire de Saint-Paul au sud de Montmagny il y a quelques années. J'aimerais bien en faire un petit montage dans ma chaîne.
RépondreSupprimerMerci de votre intérêt pour ces glanures, et d'en partager le contenu avec vos élèves.
Supprimer... et si vous en faites un montage pour votre chaîne, merci de me le faire savoir, j'aimerais bien voir cela.
SupprimerAvec plaisir. Je vous en informerai une fois le tout bâtit.
Supprimer